Le cinquième livre de l’Éthique est une mise en pratique qui succède au long développement théorique exposé dans les quatre premiers livres. Celui-ci nous aura révélé que nous sommes des modes d’une substance globale – Dieu – qui ne cesse de varier selon des lois qui lui sont propres. Notre esprit est un mode, tout comme nos idées et nos affects. Notre bien-être dépend en dernier ressort d’une saine gestion de notre affectivité, qui permet une libération à l’égard des affects passifs et négatifs qui nous asservissent. Spinoza expose à présent concrètement la voie thérapeutique, en deux étapes, qu’il entend emprunter pour parvenir à cette libération qui rime avec béatitude.

Préambule – Article #24 de la catégorie Spinoscopia
L’article qui suit s’inscrit dans le cadre d’une analyse globale de l’Ethique de Spinoza, qui a débuté avec cet article. Pour une meilleure compréhension, je vous suggère d’en suivre l’ordre.
Conflit interne et nécessité de changement
La libération telle que la propose Spinoza se fonde sur le principe exposé dans les deux axiomes qui ouvrent le cinquième livre. Ceux-ci précisent que si un sujet est en proie à une contradiction interne (des actions contraires), un changement sera nécessaire pour pallier ce conflit. Ce changement se produira en vertu, on le sait, du rapport de forces qui existe entre les deux positions antagonistes. Et la puissance de chaque position sera elle-même déterminée par la puissance de la ou des causes qui l’ont déterminée.
En d’autres termes : lorsque nous sommes tiraillés par deux idées ou deux affects contraires, celui qui l’emportera sera (ou devrait être) celui qui nous paraît le mieux étayé sur base de la prise en compte de ses causes. Le conflit interne disparaîtra dès lors qu’il nous apparaîtra clairement et distinctement, par la comparaison des causes qui les ont déterminées, en quoi l’une des positions est supérieure à l’autre.
La dissonance cognitive selon Festinger
Le processus exposé ci-dessus entre dans le cadre de ce que Léon Festinger a observé et explicité dans sa Théorie de la dissonance cognitive (1957). Cette théorie affirme que nous cherchons toujours à minimiser les insupportables tensions internes qui résultent de contradictions entre nos idées, ou entre nos croyances. Ces tensions sont elles-mêmes à la base d’affects indéniablement négatifs, a fortiori si elles concernent des croyances qui nous sont particulièrement chères, voire vitales.
Nous cherchons prioritairement, instinctivement, à maintenir intacte en nous une structure cognitive stable et cohérente – à tel point que nous tordons fréquemment le cou à la réalité pour la faire cadrer avec notre système de pensées. Cette cohérence interne semble donc nous être plus chère que l’adéquation de notre pensée avec la logique ou avec les faits.
Le changement selon Watzlawick
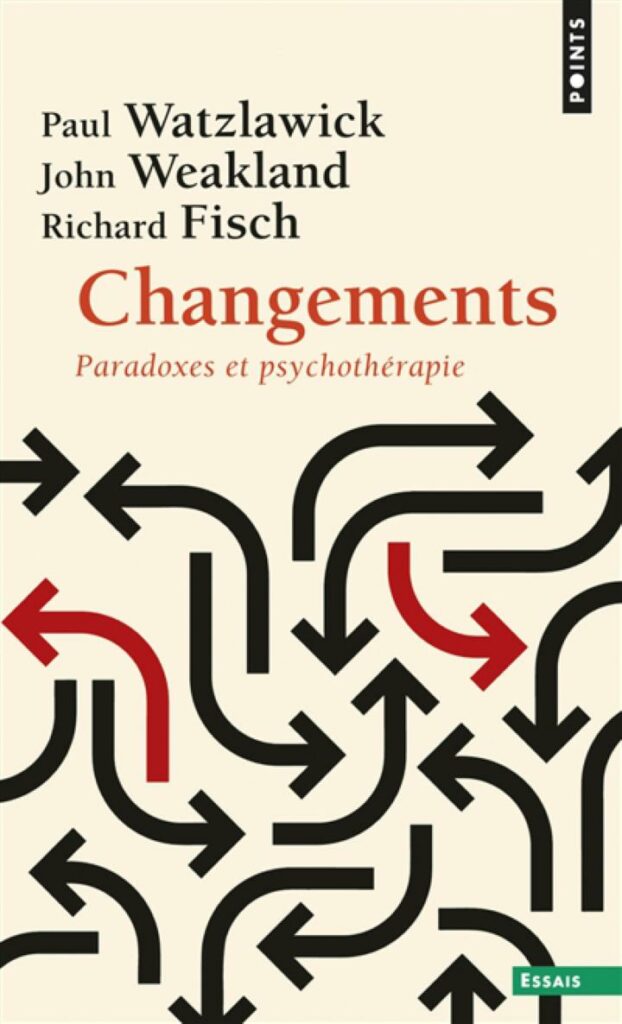
Dans le même ordre d’idée, Paul Watzlawick a mis en lumière dans son livre Changements – Paradoxes et psychothérapie (1975) une façon de procéder qui concerne l’ensemble des êtres vivants – à laquelle les êtres humains n’échappent donc pas . Il la nomme « plus de la même chose ». Watzlawick évoque l’extrême difficulté que nous éprouvons, devant la nécessité du changement d’orientation qui s’impose à nous lorsque nous traversons une crise personnelle, à modifier notre cadre de pensée, autrement dit la perspective que nous adoptons face à tel ou tel problème.
Ainsi, nous préférons penser que si nous nous retrouvons dans une impasse, notre salut viendra du fait que nous en ferons plus : nous travaillerons plus, nous prierons plus, nous nous entrainerons plus… En sommes, nous redoublerons d’effort tout en persévérant sur cette même voie qui nous enferme dans notre mal-être.
Ce que Watzlawick prône alors, plutôt que de redoubler d’effort, c’est de changer notre perspective, notre cadre de pensée relativement au problème qui se pose à nous. Considérer un problème comme un objet que l’on peut observer sous différents angles, c’est en quelque sorte le dévitaliser. Et Watzlawick de citer Épictète pour souligner son propos : « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l’opinion qu’ils en ont ».
Synthèse spinoziste: un changement fondé sur des idées adéquates…
Des deux théories que je viens d’exposer très brièvement (propension à la réduction de la dissonance cognitive, « plus de la même chose« ), tirons la conclusion spinoziste.
La réduction de la tension interne ne peut s’appuyer que sur la raison, jamais sur de petits arrangements avec la logique ou la réalité. De tels arrangements, qui correspondent à un rapport imaginatif au monde, ne peuvent nous mener pour Spinoza qu’aux passions tristes qui accompagnent les idées inadéquates.
Si la réduction de toute dissonance cognitive est bel et bien une condition sine qua non à la stabilité de l’âme, sans laquelle aucun bonheur véritable n’est envisageable, elle ne peut s’effectuer qu’à travers l’enchaînement rigoureux d’idées adéquates. Bien sûr, il nous est plus coûteux en termes d’investissement cérébral de réfléchir avec logique que de sauter sur les conclusions ou d’écarter les options qui ne cadrent pas avec nos conceptions bien établies, comme nous le faisons si souvent.
Spinoza en est conscient, lui qui clôture l’Éthique par cette interrogation :
« Si le salut était à portée de main et pouvait se trouver sans grande peine, comment pourrait-il se faire que tous ou presque le négligent ? Mais tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. »
… et sur une perspective adéquate
Ensuite, comme le souligne Watzlawick, notre mal-être prend sa source avant tout dans la perspective que nous adoptons sur les choses, ou plutôt dans l’extrême difficulté que nous avons à modifier cette perspective. Spinoza va dans le même sens lorsqu’il affirme qu’il nous faut nous départir du cadre de pensée selon lequel les choses seraient intrinsèquement bonnes (sources de joie) ou mauvaises (sources de tristesse). Les choses étant « émotionnellement neutres », c’est avant tout les causes mentales qui président à notre affectivité qu’il nous faut prendre en considération. Tel est le changement de perspective – qui correspond à une réforme de l’entendement – qu’il nous faut réaliser.
Il nous faut par ailleurs, comme il l’a abondamment suggéré jusqu’ici, changer notre appréhension du monde fondée sur le multiple et la durée, pour lui substituer une vision unitaire dans la perspective de l’éternité. Cela constituera la dernière étape de l’Ethique, que nous aborderons dans l’article #26.
Comment faire ? Un parcours en deux étapes
Ce à quoi Spinoza nous engage n’est rien d’autre que l’élimination de ce qu’on pourrait qualifier de pollution interne, à travers un cheminement qui comporte deux degrés : le premier – et le plus accessible au commun des mortels – s’inscrira dans le cadre de la vie ordinaire (celui de la durée) et s’appuiera sur le second genre de connaissance – la raison.
Au terme de cette première étape, nous aurons acquis une certaine autonomie, infiniment plus importante que lorsque nous étions soumis aux seules idées confuses engendrées par l’imagination. Mais nous ne pourrons pas encore, à ce stade, être considérés comme totalement libérés.
Le second degré de la mise en œuvre de la doctrine éthique de Spinoza s’avère autrement plus ardu – mais aussi plus énigmatique. Il consistera à dépasser le stade de la raison pour atteindre celui de l’intuition, c’est-à-dire du troisième genre de connaissance que Spinoza a brièvement introduit dans le livre 2.
Nous passerons alors à une véritable considération du monde sous la perspective de l’éternité, c’est-à-dire à une intégration profonde de la nécessité de chaque chose et de chaque événement au sein de l’être divin global.
Détachement des affects de leurs objets
Une libération de la tyrannie des passions passe avant tout, on le sait maintenant, par une rationalisation progressive de notre vie affective, qui permettra au corps d’orienter ses actions selon ses véritables besoins. Par quelles techniques y parvenir ?
Premièrement, si l’on se base sur le constat déjà posé que nos passions sont en quelque sorte attachées à des objets particuliers, il nous est possible, pour ne pas subir douloureusement un affect négatif, de le découpler de l’idée de l’objet auquel nous l’associons.
Pour ce faire, il s’agit d’analyser et de comprendre l’affect en lui-même, par ses causes, indépendamment de l’objet. Car l’objet, comme Spinoza l’a précisé auparavant, suivant Epictète sur ce point, n’est jamais en lui-même la cause de notre passion – il ne peut ainsi être dit ni bon ni mauvais absolument.
L’objet ne fait que cristalliser une passion qui résulte, à travers la mécanique des affects mise en évidence dans les troisième et quatrième livres, d’un ensemble de causes purement mentales qu’il nous faudra comprendre. Cette compréhension elle-même transforme un affect négatif en affect positif, c’est-à-dire source de joie.
Première étape donc : découpler l’affect de l’objet extérieur pour le ramener à une compréhension de la manière dont opère notre esprit pour générer un tel affect.
Force de l’entendement
Notre entendement, seul capable de former une idée claire et distincte de toutes les affections du corps, c’est-à-dire de tous les affects, fera ainsi partie intégrante de la dynamique causale qui détermine notre vie affective. Ce processus sera cette fois interne à l’esprit et ne reposera plus sur nos rencontres avec des objets extérieurs.
On pourrait ainsi en arriver à considérer que notre entendement, dès lors qu’il obéit aux normes de la rationalité, agit comme une force au sein de notre psyché. C’est une hypothèse métaphysique proche de celle que Karl Popper a soutenue dans un article/entretien datant de 1993, A discussion of the mind-brain problem.
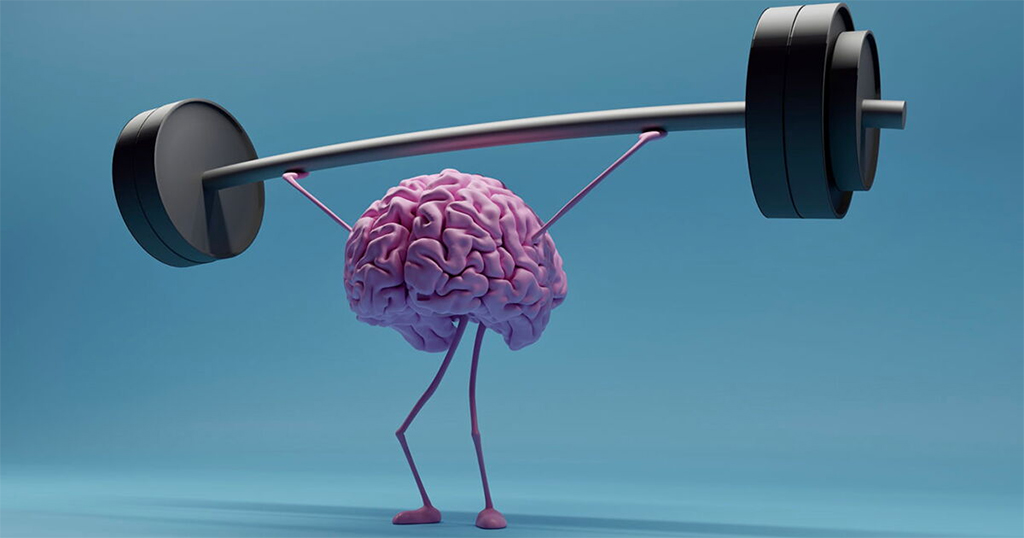
L’hypothèse de l’esprit en tant que force de Karl Popper
Pour présenter cette thèse, je m’appuierai sur un article de Joël Dolbeaut , Concevoir l’esprit comme une force, qui l’expose et la discute.
Établissons d’emblée ce qui distingue la théorie spinoziste de l’hypothèse de Popper. Pour Spinoza, l’entendement -en tant que mode du penser– est en capacité de produire des effets sur notre vie affective. Si force il y a, elle reste donc confinée au sein de notre esprit. Rappelons que pour Spinoza esprit et corps, appartenant à deux attributs distincts de Dieu, ne peuvent en aucun cas interagir l’un avec l’autre – ni donc agir l’un sur l’autre.
Or pour Popper, c’est directement sur notre action dans le monde (et donc sur le monde physique lui-même) que notre esprit joue le rôle de force ; l’intensité de cette force étant pour lui corrélée à notre intention d’agir. C’est à ce titre qu’on peut considérer sa position au sein de la philosophie de l’esprit comme interactionniste ; interaction qui existe pour le philosophe britannique entre esprit et corps, et plus largement entre pensée et matière.
Ajoutons à cela que Popper soutient la thèse dite du troisième monde, de son propre aveu proche de celle déjà discutée dans cet article ; celle d’un monde qui serait distinct de celui des objets et phénomènes physiques, ainsi que des représentations que nous en avons.
Normes de la rationalité étrangères au monde physique
Ainsi, le respect des normes de la rationalité est selon Popper un processus mental non soumis aux lois de la physique. Ces normes elles-mêmes sont indépendantes des processus physiques et de leurs représentations mentales ; elles ont une existence autonome, au sein du troisième monde – celui des produits de l’esprit humain.
Or le respect de ces normes peut déterminer un processus physique, à savoir l’exposé verbal d’une thèse. C’est là que réside pour Popper l’interaction. Des états mentaux, qui manipulent des concepts et suivent des normes de type logique qui appartiennent au troisième monde, peuvent donc avoir une forme d’influence déterminante sur le monde physique.
Pour Popper, si l’esprit n’est pas une entité physique, il partage pourtant de troublantes similitudes avec une force physique ; similitudes qui peuvent précisément nous éclairer sur la nature même de l’esprit.
Des corps et des champs de force
Il observe qu’au sein même du monde physique interagissent des entités qui appartiennent à des dimensions différentes ; il existe des corps physiques qui produisent des actions les uns sur les autres d’une part, et d’autre part un champ de forces qui président à la formation et au mouvement de ces corps – les corps eux-mêmes étant les résultats de la dynamique de ce champ.
La notion de force en physique semble ainsi irréductible à celle de la matière, ce qui amène Popper à soutenir la thèse selon laquelle il existe une dualité au sein même du monde physique entre les corps et les forces. Il fait un pas de plus en mentionnant plusieurs propriétés communes à l’esprit et aux forces physiques (notamment l’intensité, propriété qu’il attribue autant à une force physique qu’à une intention humaine d’agir).
Il ne va pas jusqu’à prétendre que l’esprit est une force physique, mais ses observations l’amènent à plaider en faveur de l’interactionnisme qu’il défend. Ainsi, il existerait des entités localisées mais inétendues et incorporelles (les forces, et l’esprit), et pourtant capables d’interagir sur les corps.
Retour à Spinoza
Pour en revenir à Spinoza et pour prolonger l’intuition poppérienne, on pourrait considérer ceci : au sein de l’esprit, les idées et les affects sont déterminés, tels des corps, à prendre telle ou telle forme selon le processus qui intervient dans leur construction; raison ou imagination. Et à ces formes que prennent ces idées et affects correspondra un comportement du corps dans le monde, via sa capacité à affecter et à être affecté.
Ceci ne constitue qu’une étape préliminaire qui nous mènera, comme nous le verrons plus loin, à associer chaque chose et chaque événement à l’idée de Dieu – ultime affect de joie.