La première étape de notre libération, l’amour envers Dieu, correspond à une révolution graduelle de notre entendement – un rééquilibrage de notre économie affective qui passe par un rééquilibrage de notre économie cognitive, qui a lieu dans la vie présente. Après avoir progressivement distingué Dieu derrière tous les phénomènes, choses et événements, nous le voyons à présent devant ceux-ci, où que nous tournions le regard. Spinoza conclut son Ethique sur un ultime chapitre – sans doute un des plus ardus – : il concerne la vie éternelle de l’esprit –qui ne doit pas être confondue avec l’immortalité. La compréhension de notre dimension éternelle équivaut nécessairement à un amour intellectuel de Dieu, ultime étape de l’Ethique de Spinoza.
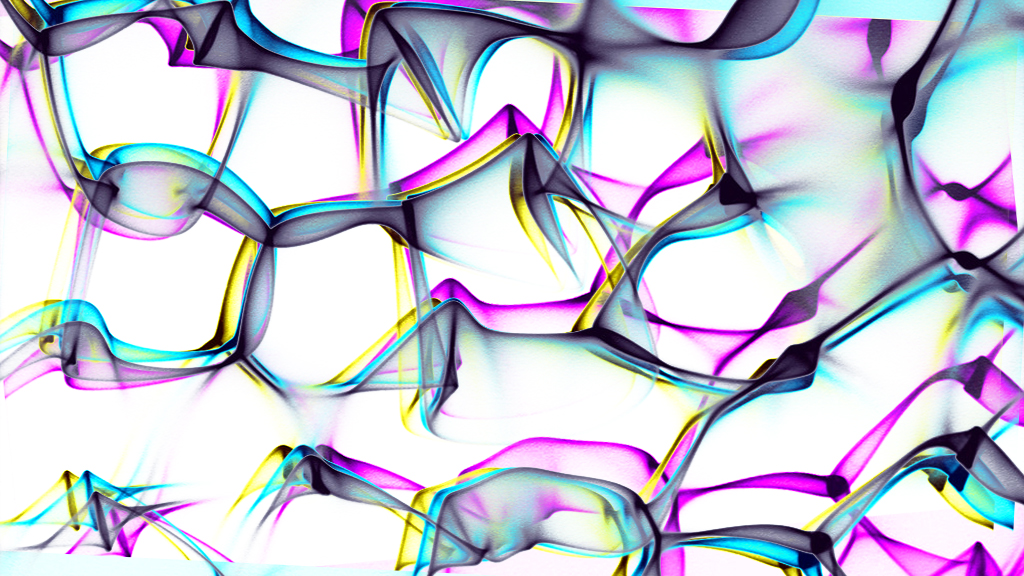
Préambule – Article #26 de la catégorie Spinoscopia
L’article qui suit s’inscrit dans le cadre d’une analyse globale de l’Ethique de Spinoza, qui a débuté avec cet article. Pour une meilleure compréhension, je vous suggère d’en suivre l’ordre.
Règles de vie
A ce stade où la rationalité, qui s’appuie sur les notions communes, est devenue en nous prépondérante, nous sommes à même de concevoir des règles de vie, de les méditer afin qu’elles pénètrent notre psyché et s’y installent durablement. Le but est que « nous les ayons toujours sous la main », dans notre vie quotidienne, et que nous puissions y avoir recours lorsque certaines situations qui pourraient nous affecter négativement se présentent à nous.
On peut concevoir ce segment pratique de l’Ethique comme une forme d’exercices spirituels, tels que pratiqués dans l’antiquité, comme Pierre Hadot les a mis en lumière dans son livre Exercices spirituels et philosophie antique.
Force d’âme
Ces règles s’inscrivent dans le cadre de l’attitude générale adoptée par le sage face à l’existence, abordée dans les livres 3 et 4 : la force d’âme, qui consiste en une fermeté envers soi-même et une générosité envers les autres.
Cette force d’âme nous engage par exemple à triompher de la haine par l’amour ; dès lors,« une offense, ou la haine qui a coutume d’en naître, occupera une très petite part de notre imagination et sera aisément surmontée ». Ainsi, nous reprenons un certain contrôle sur une passion triste qui nous assaille et nous asservit; nous sommes de ce fait plus actif et plus puissant.
Il nous faudra également toujours porter notre attention sur ce qui en chaque chose (y compris nos affects) est bon – on dirait aujourd’hui: sur le positif. Si par exemple quelqu’un est porté à rechercher la gloire, ainsi soit-il ; qu’il pense simplement à en faire bon usage, c’est-à-dire que cette gloire soit exempte d’effets nocifs pour lui-même et pour autrui.
Ceci posé, la dualité raison/passion n’est pourtant pas encore dépassée. Elle ne le sera qu’en atteignant le troisième mode de connaissance, le mode intuitif, qui saisit toute chose sous l’aspect de l’éternité.
Qu’est-ce que la vie éternelle de l’esprit ?
Les idées issues de l’imagination, les affects et les souvenirs sont des modes de l’esprit, qui ne concernent que les choses actuellement existantes. Dès lors, il est fondé d’affirmer que notre mémoire, notre imagination et notre affectivité meurent lorsque meurt notre corps. Dans le langage spinoziste : elles ne subsistent que « tant que dure le corps ». Nous sommes ainsi dans le cadre de la durée, c’est-à-dire de la finitude qui caractérise le foisonnement des modes au sein de la nature naturée.
Durée Vs éternité
Or, les idées de l’entendement saisissent, on le sait, la réalité telle qu’elle existe en Dieu (en son entendement infini) ; c’est-à-dire : sub speciae aeternitatis – sous l’aspect de l’éternité. En effet, l’idée adéquate de la nature du triangle (une figure à trois côtés dont la somme des angles égale 180°) ne mourra pas lorsque périra notre corps . Il en va de même de toutes les idées adéquates que nous possédons ; ou plutôt que nous saisissons.
Car, nous l’avons vu, Spinoza considère, en accord avec une certaine tradition philosophique, qu’une idée vraie existe indépendamment du fait qu’elle soit pensée. L’esprit possède ainsi « des yeux » qui constatent. Maxime Rovère note que la philosophe hollandais s’inscrit ainsi dans une tradition judéo-musulmane d’ascendance médiévale (CF Averroès et Aristote avec l’intellect agent) qui considère que « la pensée, profondément impersonnelle, ne s’interrompt jamais ».
Pour Spinoza, on peut penser chaque chose de deux façons : d’une part relativement à son existence actuelle (dans la durée), et d’autre part relativement à son essence « comprise dans les attributs de Dieu, de toute éternité ».
« En Dieu, il existe nécessairement une idée qui exprime l’essence de tel ou tel corps humain, sous l’aspect de l’éternité ».
Ethique 5, proposition 22
Ontologie
L’architecture ontologique spinoziste se présente donc comme suit : tout corps possède une essence singulière comprise dans l’attribut étendue de Dieu – indépendamment du fait que que ce corps existe ou non. De plus, il existe une idée (éternelle) de ce corps comprise dans l’entendement infini de Dieu. Dieu n’est donc pas seulement cause de l’existence de tel ou tel corps humain ; il l’est aussi de leur essence.
Par conséquent, la proposition 23 pose que « l’esprit humain ne peut pas être détruit avec le corps ; il en demeure quelque chose qui est éternel ». Ce quelque chose est donc l’idée éternelle qui subsiste de lui dans l’entendement infini.
Matheron souligne ici que « cette idée éternelle n’est pas autre chose que notre esprit. L’esprit est l’idée, en Dieu, de notre corps existant en acte, et cette idée est modifiée constamment par les idées plus ou moins inadéquates des affections d’origine externe ». Dès lors, la compréhension et la connaissance adéquate nous permettent d’appréhender cette part de nous, jusque-là inconsciente, qui est éternelle.
« Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels »
Ethique 5, proposition 23, scolie
La connaissance du troisième genre : l’intuition
Plus nous comprenons « scientifiquement » les choses singulières, plus nous comprenons Dieu, affirme Spinoza – les choses singulières n’étant rien d’autre que des affections des attributs de Dieu. Comprendre ces choses équivaut donc à comprendre Dieu, c’est-à-dire appréhender les essences des choses telles qu’elles existent en Dieu même.
Mais il s’agit, lors de cette ultime étape à laquelle nous ne pouvons parvenir qu’après avoir définitivement tourné le dos à l’imagination, de comprendre les choses par le troisième mode de connaissance qui, après avoir transité par la connaissance adéquate des attributs de Dieu (et donc celle des notions communes) parvient à celle des essences des choses.
Une telle compréhension constitue pour Spinoza la plus haute satisfaction, la joie la plus active, car liée au sentiment de sa propre puissance vers lequel tend notre conatus. Elle engendre un irrépressible désir d’en comprendre davantage par ce même mode de connaissance. Ainsi nous rapprochons-nous de la béatitude que vise le philosophe hollandais depuis le début de son entreprise.
Fusion avec la nature
Pierre Macherey souligne que cette satisfaction s’étend au-delà du sentiment d’accomplissement personnel ; « elle exprime la fusion de l’âme humaine et de la nature des choses ». Notre raison subit elle-même une transformation, nous donnant accès à notre dimension éternelle, par le biais de la compréhension du fait que chaque mode possède une essence éternelle.
Cette compréhension nous était inaccessible dès lors que nous envisagions les choses dans la dimension de leur existence actuelle, c’est-à-dire en relation avec une temporalité et un lieu définis. La nécessité ne connaît ni temps, ni lieu ; elle est éternelle. Cela revient à dire que comprendre les choses sous l’aspect de l’éternité, c’est les comprendre telles qu’elles existent en Dieu en suivant (de) la nécessité de sa nature.
Lorsque nous nous connaissons nous-même (corps et esprit) comme effet nécessaire de la puissance de Dieu, nous prenons conscience que nous sommes en Dieu et que nous nous concevons par Dieu. Nous sommes maintenant au stade du troisième genre de connaissance ; nous sommes aussi conscient de nous-même que de Dieu, et nous en sommes d’autant plus parfait et heureux.
Amour intellectuel de Dieu
A l’amour envers Dieu, qui résultait de la connaissance scientifique des choses et des évènements hic et nunc (ici et maintenant) sur base des notions communes, succède maintenant un amour intellectuel de Dieu qui naît de la connaissance de la dimension éternelle des essences des choses, dont Dieu est la cause.
Cet amour est lui aussi éternel. Ce qui revient à dire que les joies fragiles et éphémères que nous ressentions lors de nos rencontres fortuites avec les choses se conjuguent maintenant en une joie stable et ininterrompue. Notre esprit était parfait de toute éternité – nous n’en étions simplement pas conscient jusqu’à présent. La joie correspondait à un passage à une perfection plus grande ; nous savons à présent que nous sommes perfection, et atteignons de ce fait la béatitude.
Dieu s’aime à travers notre amour envers lui
Lorsque nous aimons Dieu d’un amour intellectuel infini, c’est en réalité Dieu lui-même qui s’aime de ce même amour. Tout comme nos idées vraies appartenaient à l’entendement infini de Dieu, que notre corps était une portion de l’étendue infinie, notre amour intellectuel de Dieu appartient à l’amour infini par lequel Dieu s’aime lui-même. Et en s’aimant lui-même, c’est toutes les choses et tous les individus que Dieu aime.
Béatitude : un amour et un savoir
La béatitude, ou liberté, est un amour constant envers Dieu, c’est-à-dire un amour de Dieu envers les hommes. C’est la connaissance intuitive des choses singulières (celle du troisième genre) qui nous rend conscient de leur éternité. La béatitude consiste donc en un savoir éternel de notre unité avec Dieu, qui nous procure une joie constante.
Comme notre esprit est lui-même une idée, éternellement vraie, présente en Dieu, de l’essence de notre corps, rien ne peut détruire notre amour intellectuel de Dieu – même pas la mort. Contrairement aux animaux, nous avons la possibilité, par l’entremise des deuxième et troisième genres de connaissance, de comprendre les choses. Alors, peut-être, avons-nous un accès possible au bonheur que les animaux ne possèdent pas. Il nous faut pour cela écarter les idées trompeuses de l’imagination, qui nous renseignent davantage sur l’état de notre corps que sur la nature du monde.
Par cette compréhension (permise par les multiples aptitudes de notre corps), nous craignons moins la mort – car « ce qui périt de l’esprit avec le corps est sans importance par rapport à ce qui demeure de lui ».
Il existe une corrélation entre perfection, entendement (la part éternelle de l’esprit) et action (le contraire de la soumission aux passions).
« (…) notre esprit, en tant qu’il comprend, est un mode éternel du penser, qui est déterminé par un autre mode éternel du penser, ce dernier à son tour par un autre, et ainsi à l’infini, si bien que tous ensemble constituent l’entendement éternel et infini de Dieu ».
Ethique 5, proposition 40, scolie
Conclusion
Spinoza conclut l’Éthique par des considérations bienvenues, car plus directement accessibles au commun des mortels – du moins ceux qui ont déjà placé leur existence sous le signe de la raison. Il précise ainsi que, même si nous ignorons que notre esprit est éternel (ce que nous a révélé le troisième genre de connaissance), les principes vertueux déjà énoncés dans les livres 3 et 4 conservent toute leur valeur.
Prescriptions de la raison
Ces principes, que Spinoza nomme « prescriptions de la raison », constituent la force d’âme que prône la vertu du sage :
- La religion désigne le désir et l’action en tant que nous avons l’idée de Dieu;
- La piété est un désir bienveillant généralisé;
- La résolution (ou fermeté) est l’attitude de l’individu rationnel envers lui-même, c’est-à-dire concernant la conduite de sa vie;
- La générosité est la force d’âme dans son rapport à autrui, sous la conduite de la raison.
Rappels sur la vertu et sur la liberté
Par ailleurs, le « premier et unique fondement de la vertu » demeure la poursuite de son propre intérêt, que la raison nous a aidé à définir. Enfin, la liberté ne consiste pas à obéir à ses pulsions ; il s’agit au contraire dans ce cas d’une servitude.
La dernière proposition de l’Éthique résume à elle seule le propos général :
« La béatitude n’est pas le fruit de la vertu mais la vertu elle-même ; et si nous en éprouvons de la jouissance, ce n’est pas parce que nous contrarions nos désirs, c’est au contraire parce que nous en éprouvons la jouissance que nous pouvons contrarier les désirs ».
Ethique 5, proposition 42
La vertu, jouissive compréhension qui s’auto-alimente et gagne progressivement tous les aspects de notre vie, nous procure l’affect actif suprême, l’amour intellectuel de Dieu, terme du développement philosophique de l’Éthique, qui triomphe de toute passion triste.
