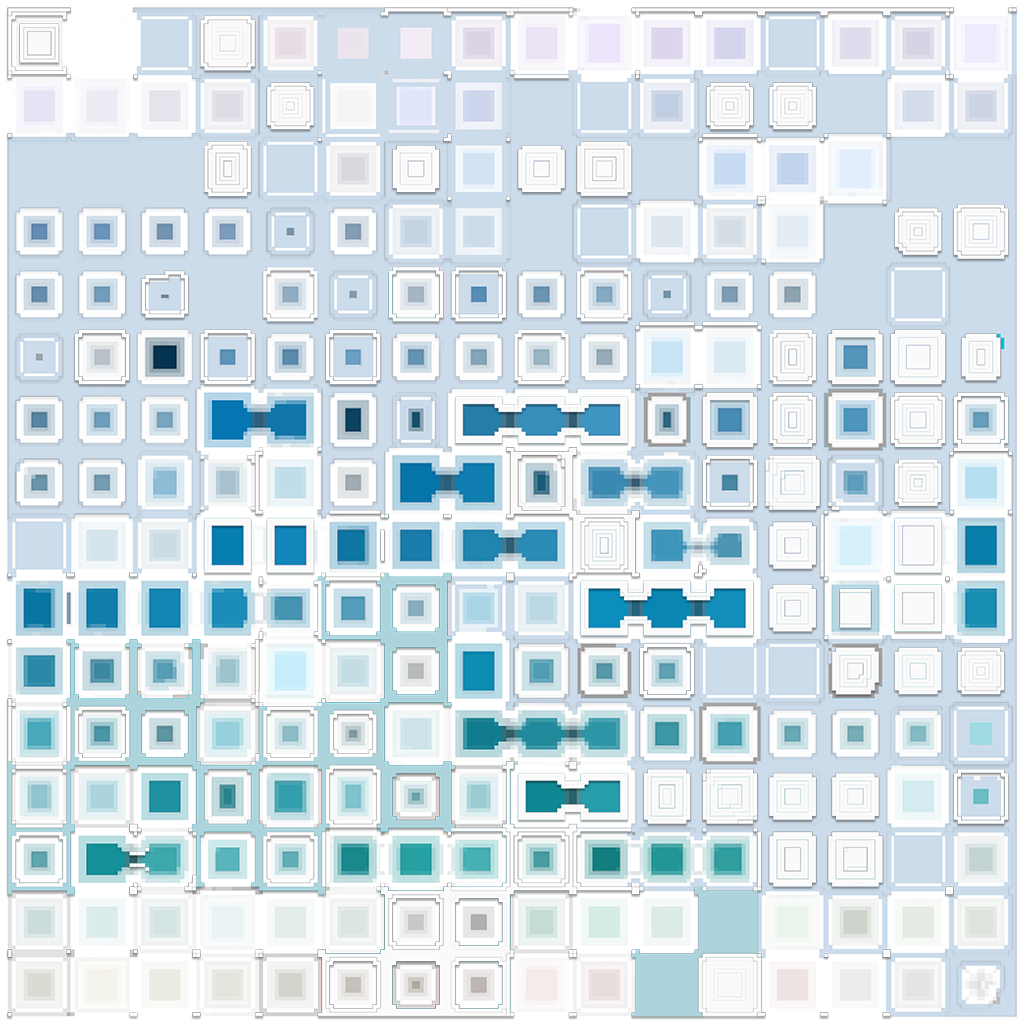A la fin du second livre de l’Ethique, Spinoza propose quelques considérations, comme souvent radicales et contre-intuitives, sur la volonté. S’il semble à première vue indubitable que nous voulons, la volonté en tant que faculté propre n’existe pas. Ce qui se produit, ce sont des volitions singulières et déterminées, qui ne sont rien d’autre que des affirmations ou des négations d’idées que nous formons. Ces affirmations ou négations agissent sur nous à la manière de forces, et à ce titre déterminent notre mouvement. Dès lors, lorsque nous voulons, c’est toujours de façon entièrement déterminée par des rapports de force entre différentes idées. Le livre 2 s’achève sur quelques enjeux pratiques de la philosophie de Spinoza.
Préambule – Article #12 de la catégorie Spinoscopia
L’article qui suit s’inscrit dans le cadre d’une analyse globale de l’Ethique de Spinoza, qui a débuté avec cet article. Pour une meilleure compréhension, je vous suggère d’en suivre l’ordre.
Résumé du livre II
Le livre 2 de l’Ethique, qui fait l’objet des quatre articles précédents, concerne l’esprit humain dans sa dimension principalement cognitive et dans l’articulation qui le relie à la pensée en tant qu’attribut divin. Il traite de la nature de notre esprit (une idée qui possède des idées), des idées qu’il est capable de former (adéquates ou inadéquates) , et de leur prépondérance sur tous les modes du penser, notamment le mode affectif.
Corps et esprit
L’être humain est pour Spinoza union de l’esprit et du corps. Ainsi uni au corps, l’esprit est d’autant plus apte à opérer que le corps auquel il est uni l’est à agir et à percevoir le monde. Spinoza a souligné en quoi les corps se distinguent les uns des autres : leur degré d’aptitudes. Il a ensuite mis en évidence les rapports de composition / décomposition entre les individus, qui résultent de l’agrégation de multiples corps par des processus qui obéissent à un ordre physique ébauché à la suite de la proposition 13 (petite physique).
Genres de connaissance
Après avoir distingué la conscience de la pensée (qui doit tendre à l’objectivité), Spinoza a ensuite abordé le mode du penser originel de notre esprit, celui de l’imagination. Ce premier genre de connaissance est toujours tributaire des rencontres de notre corps avec les corps extérieurs, et n’engendre le plus souvent que des idées inadéquates.
Il a mis en évidence le fait qu’un second genre de connaissance nous est également accessible (la raison), par lequel, à travers le recours aux notions communes, nous sommes capables de comprendre les choses adéquatement, et donc de formuler des idées vraies. Les notions communes sont universellement partagées par les humains, et constituent une base de raisonnement sur laquelle chacun peut selon Spinoza s’entendre.
A la raison doit enfin succéder le mode de connaissance intuitif, ici brièvement introduit, mais qui constitue le cœur du livre 5. Pour faire court : l’intuition intègre l’idée de Dieu comme fondement de notre appréhension du monde.
La volonté est un universel abstrait
A la fin du livre 2 interviennent des considérations sur la volonté. On le sait, Spinoza est un chantre d’un déterminisme omniscient, en vertu de quoi il nie le principe même d’une volonté dite libre. La volonté est un terme qui ne désigne rien de tangible pour Spinoza ; tout comme les autres supposées facultés de l’esprit (faculté de comprendre, de désirer, etc..), elle ne peut être considérée que comme faisant partie des universaux abstraits.

Ces universaux abstraits, à ne pas confondre, comme spécifié dans l’article précédent, avec les notions communes, ne sont pour Spinoza rien d’autre que des mots, par lesquels les êtres humains désignent des catégories de choses qui n’existent en tant que telles que dans leur façon de concevoir le monde, c’est-à-dire précisément en le classifiant par analogies plus ou moins grossières et arbitraires – en un mot : imaginatives.
Spinoza s’inscrit dans la tradition nominaliste
Le recours aux universaux abstraits taille dans la complexité du monde (en tant que nature naturée) pour rendre le réel mieux concevable ; ce faisant nous créons de toute pièce des entités qui n’existent pas en tant que telles. Tout comme l’Européen en tant que représentation autonome ne correspond à rien, la Volonté est une chimère qui n’existe que dans les esprits soumis à leur imagination. De ce point de vue Spinoza s’inscrit dans la tradition nominaliste, qui ne distingue dans le monde que des singuliers, et qui considère comme erroné tout recours à des universaux abstraits.
On peut ici remarquer qu’une figure géométrique abstraite (exemple : le triangle) n’existe pas plus dans le monde réel que l’Européen. Cette observation fait l’objet de l’article consacré au statut des définitions chez Spinoza. C’est que le triangle semble bien posséder une essence, celle d’être une figure géométrique composée de trois côtés, dont la somme des angles égale 180°. Cette essence se retrouve absolument dans chaque triangle singulier. L’emploi du terme triangle possède dès lors une valeur opératoire réelle, et son utilisation est justifiée.
Toute velléité de décrire l’essence de l’Européen comme entité abstraite est en revanche vouée à l’échec. Serait-elle strictement géographique ? Politique ? Ethnique ? Historique ? Axiologique ? Si une notion telle que l’Européen semble difficile à circonscrire, il existe en revanche des citoyens européens. Quant à savoir si un citoyen européen particulier possède une essence, c’est une question dont cet article a traité, à défaut de l’avoir tranchée.
Non pas une volonté, mais des volitions
Mais si, à l’instar de l’Européen, il n’existe pas de Volonté, pas plus d’ailleurs en Dieu que chez les êtres humains, ce dont nous sommes en revanche bel et bien dépositaires est un ensemble de volitions singulières, elles-mêmes toujours tributaires d’idées que se forme un individu.
Une volition est avant tout un mode qui appartient à l’attribut pensée ; à ce titre elle est entièrement déterminée. Qu’est-ce qui détermine les volitions ? Non pas le corps, – le corps ne possède aucun pouvoir causal sur la pensée– mais par des causes d’ordre mental, c’est-à-dire avant tout des idées.
Tout comme un affect n’existe pour Spinoza que relativement à une idée, une volition accompagne l’idée de quelque chose. Plus exactement, une volition affirme une idée. Ce que nous nommons improprement volonté est en réalité l’affirmation d’une idée que produit notre pensée, non celle d’un désir.
Vouloir = concevoir, et non désirer
Lorsque vous dites Je veux faire ceci, vous exprimez la conséquence d’un processus de raisonnement, c’est-à-dire d’un enchaînement d’idées. Cette volition singulière correspond à l’affirmation que telle action est requise de votre part, ceci en vertu d’un ensemble de raisons ou de motifs qui vous ont fait prendre conscience du caractère préférable d’une idée parmi un panel de choix possibles. Dès lors, vous voulez – sans qu’aucun libre arbitre distinct de votre intelligence n’intervienne. Il en va d’ailleurs de même lorsque vous ne voulez pas quelque chose. Spinoza s’oppose ici une fois de plus à Descartes, pour qui la volonté est une faculté distincte qui s’étend au-delà de l’entendement.
La volonté et l’entendement sont une seule et même chose.
Ethique 2, proposition 49, corollaire
Il s’agit d’une nouvelle illustration du caractère éminemment intellectualiste et rationaliste de la pensée spinoziste. L’idée, distincte de l’image d’une chose tout comme du mot qui l’exprime, est première ; elle détermine volitions et affects. Mais comment nos idées déterminent-elles nos choix? En fonction des rapports de force qui s’instaurent entre elles.
Combat d’idées
Je choisis telle option parce que telle idée me semble plus vraie. En choisissant, j’affirme une idée. Mais que se passe-t-il si deux idées me semblent également vraies ? Pour illustrer ce propos, Spinoza mentionne la fable de l’âne de Buridan.
Dans cette histoire, un âne placé à égale distance de deux ballots de foin finit par mourir de faim faute d’avoir été capable de décider lequel des deux choisir. La conclusion de Spinoza est sans appel : dans un cas de figure similaire, qui représente le comble de la passivité, un être humain périrait, tout comme l’âne. C’est un cas de figure dont on peut douter qu’il se produise jamais, néanmoins il met en lumière un problème considérable que Spinoza abordera plus profondément dans la suite de l’Éthique : celui de l’indécision de l’âme (fluctuatio animi), qui résulte de la lutte symbolique entre idées, donc entre affects et volitions.

Il paraît indéniable que notre action est facilitée dès lors que nous pouvons aisément hiérarchiser les options qui se présentent à notre entendement. Une forme d’immobilisme survient inévitablement dans le cas contraire.
Rapports de force
Rapport de force, degré, proportionnalité sont des principes centraux dans l’Éthique. Ils constituent une constante régulatrice transversale à tous les champs du réel, physiques et mentaux. Il existe des rapports de forces entre les corps, il en existe également entre les idées, et ces rapports déterminent les processus de composition et de décomposition des choses. Rappelons qu’un mode de connaissance adéquat vise précisément à comprendre ces rapports, afin d’en anticiper les conséquences néfastes ou bénéfiques.
Une volition particulière peut évidemment conduire à des conséquences désastreuses ; c’est, dans ce cas, que nous n’avons pas suffisamment ancré notre réflexion dans un mode de connaissance adéquat (deuxième, voire troisième genre de connaissance). Le programme épistémologique de l’Éthique vise précisément:
- À éviter l’erreur, qui consiste en une idée mutilée et confuse;
- À ne plus douter, c’est-à-dire à trancher le rapport de force entre deux ou plusieurs idées;
- À atteindre une forme de certitude, qui s’oppose à la conviction subjective.
Enjeux pratiques de la doctrine de Spinoza
Spinoza achève le livre 2 par un scolie dans lequel il expose quelques aspects positifs de sa doctrine. Ceux-ci; après le corpus d’affirmations théoriques présentées jusqu’ici, doivent se révéler d’une utilité pratique – d’un usage pour la vie. Que nous enseigne la raison, en fin de compte ?
Portions de nature divine
Premièrement, de tout ce qui a été dit jusqu’à présent doit émerger la connaissance du fait que nous participons de la nature divine. Cette pensée est censée selon Spinoza nous apaiser. On peut comprendre qu’elle peut effectivement, dans une certaine mesure, se révéler réconfortante. Mais ensuite, il mentionne une conséquence de cette compréhension qui ne semble pas tomber sous le sens de ce qui a été énoncé jusqu’à présent : elle devrait nous conduire à faire seulement ce que conseillent l’amour et la piété.
Cette assertion, au cœur d’un scolie, échappe au réseau déductif des propositions et démonstrations, et on se demande par quel raccourci Spinoza en arrive à mentionner, pour la première fois du texte, l’amour comme conséquence de tout ce qui précède. Lui-même ne l’explique pas davantage à ce stade.
Ensuite, la connaissance du fait que le déterminisme est partout à l’œuvre devrait nous engager à davantage de sérénité par rapport aux aléas de l’existence – ceux du moins qui échappent à notre pouvoir d’action. C’est une forme de stoïcisme qui est ici prônée par Spinoza.
Sa doctrine a en outre selon lui un impact sur la concorde sociale. La raison nous engage à ne pas haïr, mépriser ou railler autrui. Comme pour ce qui à été dit précédemment de l’amour, on doit se contenter de cette affirmation, quelque peu péremptoire à ce stade, sans autre forme d’explication. Nous en apprendrons davantage sur les sujets qui précèdent dans les livres 4 et 5, auxquels ce scolie sert finalement d’introduction.
Éthique et politique
La dernière utilité mentionnée par Spinoza est d’ordre politique : il s’agit de diriger les citoyens non en esclaves, mais afin qu’ils soient en mesure d’agir librement. Ce point est à mettre en perspective avec le propos du Traité théologico-politique (TTP), seul ouvrage publié du vivant de Spinoza, en 1670 – il interrompit d’ailleurs momentanément la rédaction de l’Éthique pour s’y consacrer. C’est la dimension politique de sa pensée, peu présente dans l’Éthique, que Spinoza expose ici plus en détail.
Dans le TTP, il s’emploie tout d’abord (comme dans l’Ethique) à dénoncer les préjugés des théologiens, qui privilégient précisément le cadre théologique à celui imposé par la raison. Dans ce traité, Spinoza ne prône ni plus ni moins qu’une théologie rationnelle, se défendant par là-même des accusation d’athéisme auxquelles il doit faire face.
Si la liberté, comme dans l’Éthique, est centrale à son propos, elle l’est moins dans le TTP à l’égard des passions individuelles qu’à celui du pouvoir exercé par l’état et par les institutions théologiques. Chacun doit être libre de ses opinions, libre de philosopher au sein de la cité.
Comprendre les affects
Perspective individuelle dans l’Ethique, dimension politique dans le Traité théologico-politique ; dans les deux cas, c’est avant tout pour Spinoza la raison qui doit servir de boussole à l’orientation, qu’elle soit individuelle ou sociale. Le cheminement eudémoniste proposé par Spinoza doit se fonder sur une saine gestion -comme toujours rationnelle- de l’affectivité ; c’est donc cette dimension de notre psyché qui sera abordée plus précisément dans le livre trois.