Nous avons vu jusqu’à présent que tous nos affects découlent des affects primaires que sont la joie et la tristesse, selon une dynamique déterministe dont les premiers jalons ont été exposés dans l’article précédent; propagation des affects entre les individus, boucles de renforcement, affects par ricochet, etc… Cette mécanique affective se situe dans un cadre entièrement passif, c’est à dire subi. Spinoza commence cependant à mentionner la possibilité d’être nous-même à la source d’affects dits actifs.
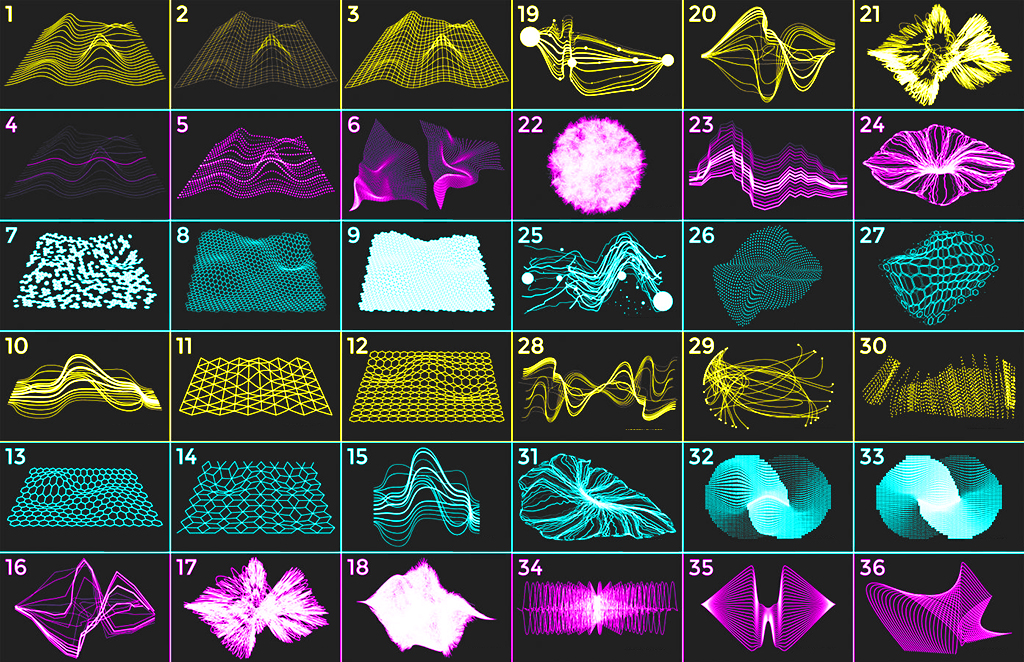
Préambule – Article #17 de la catégorie Spinoscopia
L’article qui suit s’inscrit dans le cadre d’une analyse globale de l’Ethique de Spinoza, qui a débuté avec cet article. Pour une meilleure compréhension, je vous suggère d’en suivre l’ordre.
Rappel des premiers principes de la mécanique affective
L’article précédent expliquait que nos affects se fixent à des objets, et sont influencés par le contexte dans lequel nous avons initialement rencontré ces objets. Ils se propagent entre individus. Ils engendrent des comportements dont le fondement est inévitablement autocentré. En compétition perpétuelle avec d’autres affects en nous, ils se renforcent ou s’affaiblissent, s’engendrent ou se bloquent mutuellement. Ils sont à la base de notre catégorisation bipolaire et subjective des objets du monde en bons ou mauvais. Notre conatus nous pousse quant à lui à un effort permanent de maximisation de notre joie et de minimisation de notre tristesse.
Poursuivons maintenant avec de nouvelles observations de Spinoza concernant ce que Pierre-François Moreau nomme la Civilisation de nos passions.
Réciprocation des affects
Que ressentons-nous lorsque nous prenons connaissance des affects des autres à notre égard ? De nouveaux affects, bien évidemment. Spinoza met en évidence la dimension pavlovienne (et donc déterminée) de la réciprocation, positive ou négative, de nos affects relativement aux affects qu’autrui nourrit à notre égard. Celle-ci est distincte de la propagation des affects entre individus mise en évidence précédemment.
Quelques exemples concernant la haine et l’amour
Si nous sommes haï sans motif jugé valable, nous haïssons en retour. Si nous jugeons au contraire le motif de la haine d’autrui à notre égard justifié, nous ressentons de la honte. Ce cas de figure se produit peu souvent il est vrai, notre conatus nous engageant à lutter contre une telle pensée. Les êtres humains sont dès lors beaucoup plus disposés à leur propre glorification qu’à la honte, à la vengeance qu’à la gratitude. Ce qui s’oppose à notre conatus est le sentiment de faiblesse ; en quête d’une plus grande puissance d’agir, nous valorisons presque systématiquement le sentiment de puissance lui-même, quitte à le gonfler artificiellement.
Cela se complique si nous sommes haï par une personne que l’on aime ; un douloureux conflit interne en découle inévitablement. Si par ailleurs nous sommes aimé par quelqu’un sans en comprendre précisément le motif, nous ne manquerons pas de l’aimer en retour. La haine est augmentée par la haine réciproque, et détruite par l’amour réciproque. Ainsi vaincue par l’amour, elle se transforme elle-même en amour – amour d’autant plus important que ne l’était la haine initiale.
La jalousie est un affect qui résulte de notre volonté d’exclusivité ; nous désirons que tout le monde aime ce que nous aimons, mais que ce que nous aimons n’aime que nous. L’affect de jalousie consiste en une combinaison de haine à l’égard de la personne aimée et d’envie à l’égard de la tierce personne qui jouit de l’amour de la personne aimée. Par ailleurs, la haine à l’égard d’une chose qu’on a aimée est plus importante que la haine d’une chose qui nous était auparavant indifférente.
Triangulation, diffusion et concentration

Il existe de surcroît une haine et un amour de second degré, par personnes interposées. Si André aime Bernard et que Bernard hait Charlie : André hait Charlie. Mais si André hait Bernard et que Bernard hait Charlie : André aime Charlie. On peut donc noter qu’André est capable de nourrir des sentiments à l’égard de Charlie alors même qu’il ne l’a jamais rencontré.
Les ennemis de mes ennemis sont mes amis – même si l’on ne partage rien d’autre avec eux qu’une haine commune. Nos affects à l’égard de quelqu’un s’étendent en outre au groupe dont il fait supposément partie, selon la logique : Charlie hait Christiano Ronaldo ; Christiano Ronaldo joue au Real Madrid ; Charlie hait l’équipe du Real Madrid et l’ensemble de ses supporters. Et si un nouveau joueur s’engage au Real Madrid, peu importe que Charlie n’ait jamais entendu parler de lui : il ressentira à son égard une forme de haine du fait de le voir appartenir à un groupe qu’il hait.
Stigmatisation
Nous avons en outre tendance à considérer la chose haïe dans ce qu’elle a de différent de nous afin de mieux la haïr ; c’est le principe à l’origine de la stigmatisation. Spinoza précise que nous ne ressentons pourtant pas de véritable joie lorsque nous imaginons détruite la chose haïe, d’autant plus si elle nous ressemble. La véritable joie est positive ; elle est engendrée par la joie d’autrui, non sa tristesse. Ce que nous ressentons vis-à-vis du malheur de notre ennemi – ou supposé tel – n’est qu’un ersatz de joie.
Rôle causal des individus dans nos affects
Notre amour et notre haine sont en outre proportionnels au rôle causal que nous attribuons aux individus. Tel individu est-il cause unique de notre affect? cause partielle ? cause principale ? A quel point est-il jugé par nous responsable de l’action qui a engendré notre affect ? Nous le considérerons d’autant plus responsable que nous le considérons libre d’avoir effectué son action. Ainsi, pour une même douleur que nous ressentons, notre haine sera plus importante si nous jugeons qu’autrui l’a fait exprès, ou moindre si nous pensons qu’il est moins responsable de ses actes, ce qui est le cas d’un enfant par exemple.
Rappelons ici que Spinoza récuse le libre arbitre, et donc la possibilité pour un être d’agir librement. Dès lors que nous comprenons les événements, et donc les actions d’autrui, comme nécessaires en ce qu’ils sont eux-mêmes produits par un ensemble d’autres événements, l’affect qui naît en nous en sera tempéré. La compréhension du fait que les autres (et nous-même) sont déterminés à agir tel qu’ils le font doit nous disposer selon Spinoza à davantage de mansuétude à leur égard.
Danger de l’intellectualisme?
Une remarque sur ce point. N’y a-t-il pas un danger à intellectualiser de la sorte nos sentiments ? Si cela peut s’avérer bienvenu dans le cas d’affects négatifs tels que la haine, le ressentiment, la jalousie, etc… on peut se demander quel est l’impact de cette rationalisation sur nos affects positifs. Ne court-on pas le danger en les mettant de la sorte à distance, de ne plus les vivre authentiquement ?
Si j’aime mes enfants, n’est-il pas quelque peu inapproprié de méditer sur le fait que je les aime peut-être avant tout parce que l’évolution, la génétique, la survie de l’espèce l’exigent ? Cela vaut-il la peine de se demander pourquoi on aime telle musique, telle couleur, telle œuvre d’art ? Si l’on pense que c’est une chose à éviter, il paraît justifié de se limiter à une rationalisation asymétrique des affects, en ne l’appliquant qu’aux émotions négatives que nous ressentons, et en laissant la joie et le plaisir, dès lors qu’ils n’engagent que nous, vierges de toute investigation intellectuelle.
Pour Spinoza, tout affect subi, même la joie ressentie en présence d’un être aimé ou d’un plaisir esthétique, en tant qu’il provient de l’extérieur de nous-même, est une passion. A ce titre, même s’il n’est pas néfaste en soi, il passera toujours au second plan comparativement à l’affect actif de joie qui résulte d’une connaissance rationnelle du fait que (ce sera l’objet du cinquième livre) chaque chose appartient à l’essence divine.
Concluons ce point par ceci: tout les affects positifs ne constituent pas pour nous un pas vers l’épanouissement – même s’ils en donnent toutes les apparences. Mais certaines passions semblent tout de même inoffensives, voire même authentiquement bénéfiques; c’est le cas, notamment, lorsqu’elle touchent à la simple contemplation du monde, indépendamment de toute velléité de compréhension.
Inconstance
On le sait, un même objet peut être à l’origine de différents affects chez différents êtres humains. Mais un seul objet peut également être à l’origine de différents affects au sein d’un seul être humain, en fonction notamment du moment où il rencontre cet objet. Notre évaluation des événements est mouvante, aléatoire ; elle est tributaire, comme nous l’avons déjà abordé, des circonstances extérieures dans lesquelles nous sommes confronté à cet événement, mais aussi de notre complexion interne, elle-même dynamique, ou plus précisément inconstante.
Une même situation peut ainsi nous paraître insupportable à un moment et acceptable à un autre – selon notre humeur, c’est-à-dire notre configuration émotionnelle à un instant donné. Ceci est une nouvelle illustration du fait que nos jugements sont initialement tributaires de notre imagination.
Fascination pour le singulier
Notre concentration est davantage aiguisée par le fait que nous rencontrons une chose singulière et inhabituelle. Notre esprit différencie volontiers l’ordinaire de l’extraordinaire, et concentre son attention sur une chose qui ne lui paraît pas renter dans les catégories par lesquelles il a coutume d’appréhender le monde. L’étonnement, que Spinoza nomme admiration, n’est pas une émotion en lui-même mais une modalité de notre rapport affectif au monde. Il intensifie notre affect selon la singularité que nous prêtons à un objet particulier.
Autocongratulation, envie et complexe de supériorité
Nous n’affectionnons rien plus que de constater notre propre puissance ; elle est la source de joie ultime, et la satisfaction de nous-même, ou amour-propre, est quelque part la finalité de notre pensée.

Cette joie est majorée par le fait que nous observons également ce constat de puissance dans le regard qu’autrui porte sur nous. Nous nous efforçons toujours (conatus) d’imaginer tout ce qui pourrait nous permettre d’augmenter notre puissance, et nous répugnons à imaginer toute situation qui menacerait de la diminuer. Spinoza qualifie d’humilité la tristesse qui accompagne l’idée de notre propre faiblesse.
Notre prétention naturelle nous pousse en outre à la comparaison et à la rivalité ; nous affectionnons en effet nous imaginer supérieur aux autres et répugnons à nous considérer comme médiocre au sein d’une communauté. Cela nous engage à surestimer l’importance de nos actes et à minimiser les réussites d’autrui alors même que nous les envions secrètement.
Chacun brûle de raconter ses exploits et de faire étalage de sa force, (…), ce qui rend les hommes pénibles à supporter les uns pour les autres.
Ethique 3, proposition 55, scolie
Admiration, tant qu’on ne nous fait pas de l’ombre
Cette haine de la réussite des autres ne s’applique cependant qu’à ceux avec lesquels nous considérons « jouer dans la même cour ». Si nous estimons posséder des aptitudes équivalentes à quelqu’un, nous n’accepterons pas qu’il soit couronné de succès et pas nous. Son succès nous met face à notre propre impuissance, ce qui nous est intolérable.
Nous ne nous autorisons à admirer que ceux dont nous pensons qu’ils sont particulièrement talentueux, de préférence dans un domaine qui nous est radicalement étranger. Donald Trump lui-même concède que Jésus Christ est « le véritable boss ».
Possibilité d’affects actifs
En vertu du mécanisme de fixation subjective d’affects sur des objets, il y a en nous autant d’affects que d’objets – ou de catégories d’objets, selon le principe de l’association imaginative. Chaque état de fait, chaque événement est affectivement labellisé, mais de manière inadéquate, comme Spinoza s’est évertué à le démontrer jusqu’à présent ; nos affects sont tous, tant qu’à présent, assimilés à des passions.
Le troisième livre de l’Éthique se conclut sur une possibilité de construire une joie et un désir actifs. Comment ? Lorsque notre esprit fonctionne sous le régime de la raison, il forme des idées adéquates. Il est alors affecté de joie en constatant sa propre puissance de penser, et constitue ainsi une cause adéquate de joie. La cause de notre joie est interne ; dès lors, nous agissons. Et le désir engendré par les idées adéquates sera lui aussi actif, en ce sens qu’il sera déterminé non plus par les aléas des circonstances externes, mais par la puissance de penser de notre esprit.
Lorsque quelqu’un est heureux et que nous ne le sommes pas, ne se dit-on pas qu’il a compris quelque chose qui nous échappe ?
Force d’âme
Ce à quoi Spinoza nous engage ici, c’est à coupler notre conatus à la raison – à faire preuve de force rationnelle. Il nous exhorte à trouver aux problèmes qui se présentent à nous des solutions authentiques, personnelles et raisonnablement étayées – on pourrait presque dire : mathématiquement fondées.
Il appelle force d’âme cette attitude face à la vie ; celle-ci est à l’origine des affects actifs et d’une puissance d’exister accrue. La force d’âme est résolution, fermeté à l’égard de soi-même et générosité dans son rapport aux autres. Orientée vers soi-même elle engendre tempérance, sobriété, présence d’esprit. Orientée vers les autres : amitié, modestie, clémence. La force d’âme est le résultat de raisonnements adéquats qui orientent notre action dans le sens d’une autonomie accrue.
Notons que la force d’âme est étrangère à l’ambition, affect quasi insurmontable qui constitue la faiblesse, « même des meilleurs ».
Conclusion du livre 3
Toute la tradition philosophique a constaté que notre émotivité est fluctuante, que nous en sommes en quelque sorte esclaves. Spinoza s’est quant à lui donné pour objectif, au-delà du simple constat, d’expliquer comment ces conflits internes naissent des flux contraires qui nous traversent. Cette explication liminaire est indispensable dès lors qu’on comprend que la volonté et l’action sont déterminées par les affects : on ressent d’abord de la joie ou de la tristesse accompagnée d’une cause extérieure (amour ou haine), ensuite on veut la posséder (ou l’éliminer) ; on agit alors en ce sens.
Comment faire face aux passions tristes?
- Par une passion contraire : c’est le principe, que nous privilégions naturellement, de fuite par ce qu’on pourrait qualifier de comportements de compensation. Attristé par une situation, nous recherchons une autre situation qui nous fera oublier notre tristesse en générant une nouvelle passion, de joie, sans pour autant confronter notre passion triste initiale;
- Par un affect actif : il s’agit d’un processus centralisé par la raison : une idée adéquate générera un affect actif de joie.
Les livres 4 et 5 approfondiront la voie éthique qui nous conduit vers l’élaboration rationnelle d’affects actifs.