Pour Spinoza, limiter l’impact des passions tristes sur notre esprit passe avant tout par une rationalisation progressive de notre vie affective. A cette rationalisation de l’esprit correspondra, parallèlement, une rationalisation du corps; nous pourrons dès lors orienter nos actions en fonction d’une utilité maintenant conçue adéquatement. Par quelles techniques y parvenir ? Par un découplage de nos passions et des objets extérieurs auxquels elles se joignent, et par une reconnaissance de la nécessité partout à l’oeuvre. Cette reconnaissance se muera bientôt en amour envers Dieu, avant de devenir, enfin, amour intellectuel de Dieu.
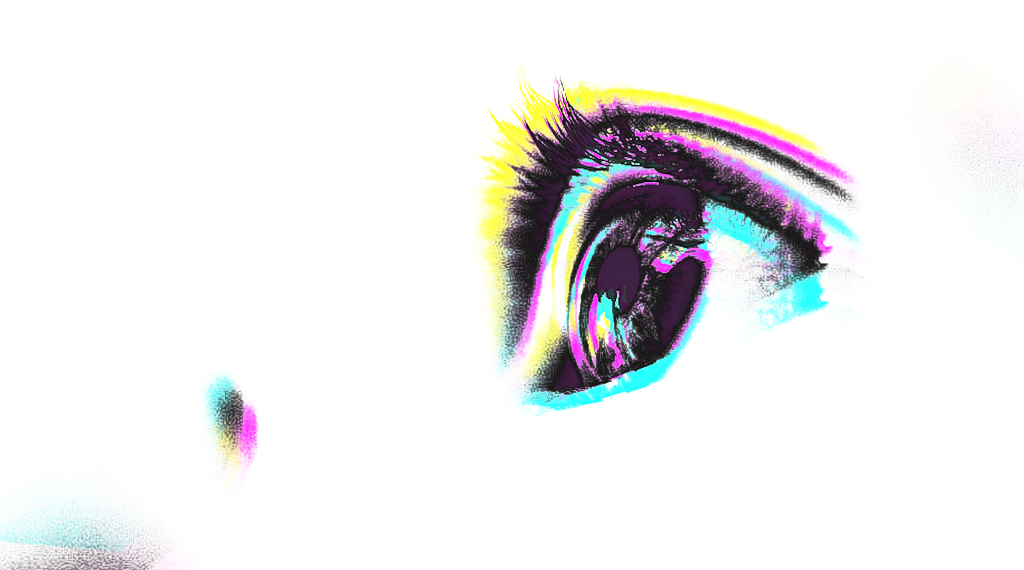
Préambule – Article #25 de la catégorie Spinoscopia
L’article qui suit s’inscrit dans le cadre d’une analyse globale de l’Ethique de Spinoza, qui a débuté avec cet article. Pour une meilleure compréhension, je vous suggère d’en suivre l’ordre.
Comment rendre notre raison affective ?
Résumons le cheminement de l’Ethique jusqu’à présent. La compréhension du monde – que Spinoza considère d’une utilité suprême – par la formation d’idées claires et distinctes, est une action de l’esprit qui exprime sa perfection, au contraire de la formation d’idées inadéquates engendrées par l’imagination. L’esprit d’un individu accède par l’entendement aux idées telles qu’elles existent au sein de l’entendement infini de Dieu.
Comprendre revient à augmenter sa puissance d’agir, corellée à un sentiment de joie. Cet affect puissant peut venir à bout d’une passion triste, en vertu du principe de rapport de forces inhérent à la nature naturée, qui met en relation tous les modes finis. La liberté passe donc par la connaissance, et la connaissance est une jouissance. Nous nous efforçons enfin de communiquer cette joie à autrui en l’aidant à cultiver son entendement. Tel est le principe de générosité qui tend à établir une communauté d’individus au sein de laquelle règne la concorde.
S’articulent donc dans l’éthique spinoziste raison, action, joie, puissance, liberté et concorde sociale.
Limiter l’impact des passions tristes
Nous avons vu dans l’article précédent que Spinoza propose une première technique permettant de limiter l’impact d’une passion triste sur notre esprit: il s’agit de focaliser notre attention non plus sur l’objet qui cristallise notre affect, mais sur l’affect lui-même, qu’il s’agira de comprendre. Ce découplage préliminaire nous mènera, comme nous allons le voir, à associer chaque chose et chaque événement non plus à un objet particulier, mais à l’idée de Dieu – ultime affect de joie.
Comprendre un affect, c’est en comprendre les causes, qui découlent des lois générales de la nature que nous avons intégrées.
Spinoza précise qu’une telle compréhension est possible ; nous ne sommes pas inexorablement cantonnés au premier genre de connaissance (celui de l’imagination). La première solution proposée par Spinoza est en fait celle qui a déjà été largement abordée tout au long de l’Éthique : une transition de notre réflexion de l’imagination à la raison, c’est-à-dire un savoir fondé sur les notions communes.
Affects actifs Vs affects passifs
Un même affect peut être actif ou passif selon le régime mental (imagination ou raison) qui lui a donné naissance. Le désir par exemple est actif en tant qu’il est issu d’un enchaînement d’idées adéquates qui se fonde sur les notions communes, mais passif lorsque soumis à celui des idées mutilées et confuses. Un affect est dit mauvais par Spinoza dans la mesure où « l’esprit est empêché par lui de pouvoir penser ».
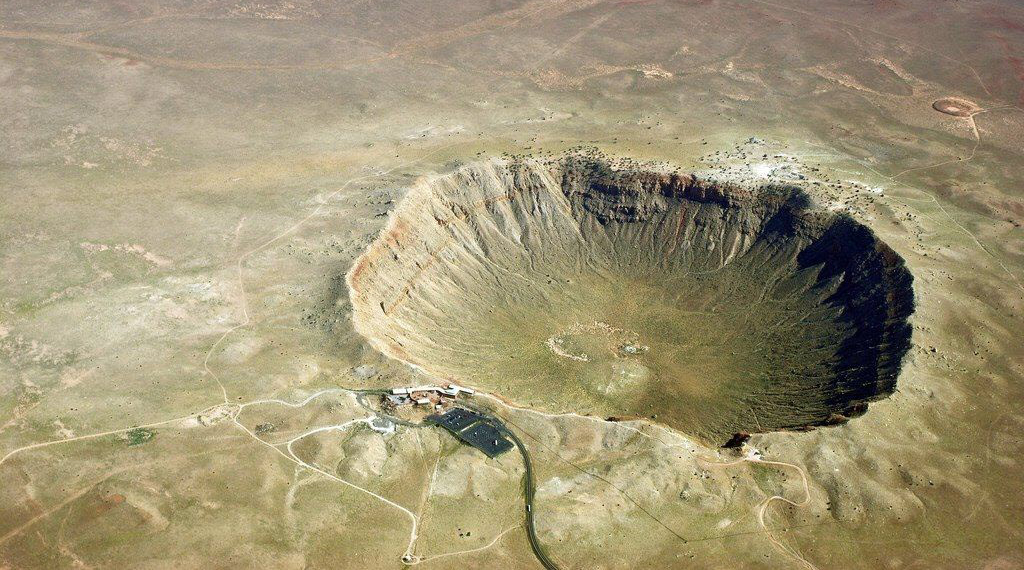
Reconnaître la nécessité partout à l’œuvre
Lorsque nos affects concernent des événements que nous considérons comme résultant d’une liberté d’action (il m’a marché sur le pied), ils nous atteignent davantage que ceux que nous considérons comme nécessaires (il pleut). Or, pour Spinoza, on le sait, rien n’échappe à la nécessité. Si il m’a marché sur le pied, causes et raisons se confondent en un déterminisme strict qui n’aurait pu résulter en aucun autre cas de figure. Il m’a, certes, marché sur le pied, mais ce geste résulte de son aigreur, qui résulte elle-même de son vécu – peut-être douloureux -, qui lui-même résulte de…
Comprendre les choses de cette manière (tout est nécessaire), c’est déjà mettre une passion à distance, limiter son impact sur nous – c’est être plus actifs à son égard. Envisager le monde comme un vaste Nexus Causarum (un tissu causal où nous considérons chaque chose et chaque événement comme absolument nécessaire car relié à un vaste ensemble de causes) fournit une sorte de rempart contre la tyrannie des affects. Il ne s’agit pas ici d’un fatalisme résigné, mais plutôt d’une joie active de comprendre, qui minimise l’impact des passions tristes sur notre esprit.
Spinoza précise ensuite que plus de choses concourent à exciter un affect, plus cet affect est important. Il observe en outre que considérer un grand nombre de causes à notre affect diminue son caractère néfaste. On peut ainsi métaphoriquement établir que la charge affective qui accompagne un événement se répartit sur de nombreux objets dès lors qu’on adopte une perspective plus vaste sur le monde.
Joël De Rosnay appelle macroscope, dans son livre éponyme publié en 1975, cet instrument intellectuel qui permet d’élargir indéfiniment l’angle de vue lors de notre observation des phénomènes – dans le cadre de la pensée spinoziste, cette focale finit par embrasser l’univers entier, dans sa dimension éternelle.
Rationaliser l’esprit, c’est rationaliser le corps
Comprendre, c’est-à-dire enchaîner les idées adéquates sur le plan de l’esprit, s’accompagne d’un enchaînement d’actions du corps lui aussi adéquat. Rappelons que notre corps possède une grande aptitude à affecter et à être affecté, c’est-à-dire à sentir le monde d’une part, et à produire des effets d’autre part.
Adapter son environnement
Par la raison, nous sommes dès lors en mesure d’agir en aménageant notre environnement – notre milieu naturel et social – de façon à ce qu’il agisse en retour sur nous en produisant les effets qui nous sont véritablement utiles, c’est-à-dire bénéfiques. C’est ainsi qu’à l’activité de l’esprit correspond une activité du corps, qui lui-même, par son action, permet de fournir à l’esprit en retour des sources de joie véritable.
Un nouvel affect en gestation : l’amour envers Dieu
Nous avons donc à ce stade rompu la liaison que nous établissions spontanément entre un affect et un objet précis. Ensuite, nous avons réorienté notre concentration non plus sur cet objet mais sur la façon dont notre esprit engendre l’affect. Enfin, nous avons progressivement changé notre regard sur le monde, en y distinguant la nécessité qui se manifeste à travers chaque événement.
Spinoza nous propose à présent de produire un nouvel affect joyeux, d’une puissance inégalable : l’amour envers Dieu.
Systémique des idées
Le fonctionnement naturel de notre intellect peut faciliter ce processus. Celui-ci tend, en s’élargissant, à se structurer par agglomération d’idées en schèmes qui se solidifient peu à peu.
Les propositions 11 à 13 du cinquième livre énoncent ainsi que :
« Plus il y a de choses à quoi une certaine image se rapporte, plus elle est fréquente, autrement dit plus souvent elle prend de la force, plus elle occupe l’esprit ».
« Les images des choses se joignent, plus facilement qu’aux autres, aux images qui se rapportent à des choses que nous comprenons clairement et distinctement ».
« Plus il y a d’autres images à quoi une certaine image a été jointe, plus souvent elle prend de la force ».
Corporel et mental: Spinoza estompe les frontières
On constate ici une fois de plus à quel point la pensée de Spinoza estompe les frontières communément admises entre mondes physique et mental : au sein de l’esprit, les notions de quantité, de fréquence, d’agrégation, de force et d’étendue sont tout aussi valides que dans le monde matériel. A tel point qu’on peut se demander si ce n’est pas la notion même de matière qu’à la lumière spinoziste nous devons fondamentalement reconsidérer.
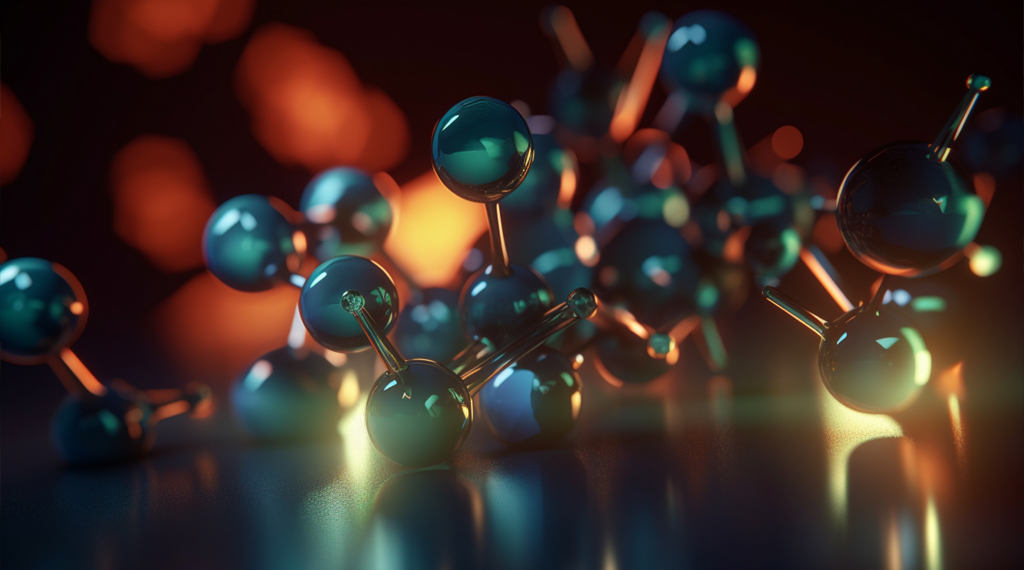
Ce qui est ici exposé, c’est une systémique du monde mental : il existe des nœuds au sein de notre intellect, qui correspondent à des agrégats d’images. Chaque image possède un poids et une force en fonction du nombre de choses auxquelles elle se rapporte et de la fréquence à laquelle nous rencontrons ces choses.
Pôles attractifs
Les images des choses dont nous formons des enchaînements adéquats sont des attracteurs pour les autres idées ; nous cherchons spontanément à y associer de nouvelles images. Soulignons que ce processus vaut aussi bien pour les idées vraies que les idées fausses : on peut enchaîner adéquatement des idées à partir de prémisses erronées, et parvenir logiquement à des solutions tout aussi erronées.
On peut presque y voir une géographie de l’esprit : nos structures cognitives sont telles des mégalopoles autour desquelles s’implanteraient des banlieues de plus en plus nombreuses, jusqu’à se faire absorber par des villes qui s’étendent toujours davantage. Plus la ville est correctement agencée, plus elle favorise l’implantation de nouveaux quartiers, plus elle tend à occuper du terrain et à générer de l’activité.
Ainsi, les règles de vie fondées sur la force d’âme peuvent constituer des pôles attractifs auxquels nous rapporterons toujours davantage d’idées et de situations.
Mutation de l’intelligence : tout se rapporte maintenant à Dieu
A présent, notre raison est à même de canaliser nos passions. Mais, comme le dit Alexandre Matheron : « l’actualisation de notre essence n’est pas encore réalisée, (…) le commandement de la raison nous provient de l’universel, il n’est pas encore l’expression de ce qu’il y a de singulier en nous ».
La révolution que Spinoza propose – il l’imagine d’ailleurs dès son Traité de la réforme de l’entendement, écrit inachevé produit entre 1665 et 1670 -, est de faire en sorte que toutes les affections du corps, qui donnent lieu en nous à des images des choses, se rapportent maintenant à l’idée de Dieu – et non plus seulement aux notions communes et aux lois de la nature.
La connaissance de Dieu mène à l’amour de Dieu
Se comprendre soi-même et comprendre le monde de cette façon implique d’ailleurs automatiquement que nous aimons Dieu. Car, rappelons-le, la compréhension est en elle-même source de joie, et dès lors que cette joie se rapporte à l’idée de Dieu, en vertu de la définition spinozienne de l’amour : nous aimons Dieu.
Et comme cet amour concerne maintenant toutes les sources d’affection du corps, en tant qu’elles constituent Dieu, il occupe la plus grande place dans l’esprit. Notons que, Dieu étant perfection, il ne peut pas, comme nous le faisons, éprouver les variations de perfection qui résultent en des affects de tristesse et de joie.
« Dieu n’éprouve pas de passion, et nul affect de joie ou de tristesse ne l’affecte »
Ethique 5, proposition 17
Objection
Une objection classique consiste à considérer que si Dieu est cause de tout, il l’est également de la tristesse. Comment alors peut-il être si aimable ? Spinoza rétorque qu’une tristesse (passion triste) connue par ses causes cesse de ce fait d’être une tristesse et devient joie active. Ceci implique une considération plus générale, déjà mentionnée : il n’existe pas de mal en soi.
Soyons conscients, en outre, de ceci :
« Qui aime Dieu ne peut faire effort pour que Dieu l’aime en retour »
Ethique 5, proposition 19
Aucun culte n’est nécessaire, pas plus qu’il n’est besoin de rendre hommage à Dieu. Dieu ne nous voit pas ; il ne nous aime pas davantage, pour la bonne raison que l’amour, en tant qu’affect, lui est étranger. Tout au plus pouvons nous dire que c’est à travers nous que Dieu aime. Nous pouvons de notre côté nous contenter d’un amour désintéressé envers Dieu, exempt de l’envie et de la jalousie dont nous avons coutume de faire preuve relativement aux choses du monde.
Spinoza ne le précise pas explicitement, mais avançons que si culte il peut y avoir, c’est dans la contemplation de la nature de Dieu, et dans l’effort joyeux de le comprendre et de le connaître.
Un amour partagé
On le sait, cet amour envers Dieu est par nature partageable à l’infini sans que nous n’en soyons affectés d’une quelconque frustration – comme ce pourrait être le cas avec, par exemple, une somme d’argent. Au contraire, affirme Spinoza : l’amour envers Dieu est d’autant plus jouissif que nous imaginons plus d’êtres humains unis à Dieu par ce même lien d’amour. Il n’est donc pas un exercice solitaire, mais a vocation à se transformer en pratique collective.
De ce qui précède, on peut conclure que « croire en Dieu » n’a, dans une perspective spinoziste, pas beaucoup de sens. Il s’agit davantage pour le philosophe hollandais de connaître Dieu – et de le reconnaître partout où nous posons le regard. Automatiquement, l’amour envers Dieu, qui constitue la première étape de libération exposée dans le cinquième livre, en découlera.
Résumé
Le scolie de la proposition 20 récapitule le cheminement thérapeutique présenté jusqu’ici :
- Connaissance claire et distincte des affects et de leur caractère nécessaire (elle faisait l’objet des livres 3 et 4)
- Désobjectivation / découplage de nos affects des choses que nous ne comprenons que confusément
- Agrégation, consolidation, structuration des notions communes que nous assimilons ; dans le temps, les affections se rapportant à des choses que nous comprenons adéquatement l’emportent sur celles que nous ne comprenons que confusément
- Multiplicité des causes des affects qui se rapportent aux propriétés communes des choses et à Dieu
- Enchaînement et ordonnancement correct des affects : la raison au service de l’affectivité
Nous sommes jusqu’à présent toujours immergés dans le cadre de la vie présente, celui de la durée, dans lequel les idées vraies de la raison prennent peu à peu le pas, proportionnellement, sur les idées engendrées par l’imagination. Le prochain article abordera l’ultime étape du développement éthique spinoziste : l’amour intellectuel de Dieu. Celui-ci résulte quant à lui non plus seulement de la raison, mais de l’intuition, et s’inscrit dans le cadre de l’éternité.